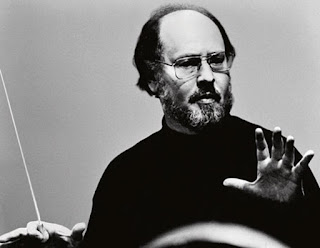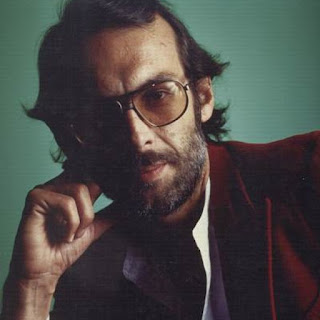Chaînes conjugales

Un métrage, une image : Adorables créatures (1952) En découvrant en version restaurée ce divertissement d’un autre temps, on sourit et on rit souvent, à l’instar de son anti-héros guère miso, même un peu miro, « doudou Dédé » séducteur idéaliste dessinateur de soutifs façon Sueurs froides (Alfred Hitchcock, 1958), mec « moyen » auquel Daniel Gélin sait aussi accorder avec subtilité sa mélancolie au masculin. Co-écrit par Jacques Companéez, le scénariste du contemporain Casque d’or (Jacques Becker, 1952), d’accord, Adorables créatures aux dialogues de Charles Spaak carbure, par conséquent leur constante ironie ne possède l’acidité d’un Jeanson, le chaos d’un Clouzot ; on s’amuse plus que l’on ne se moque, on ne cède au cynisme ni ne succombe à l’anecdote. Précédé d’un prologue surprenant et pertinent, tant pis pour la « script-girl » qui dut tirer la gueule, muni d’un « commentaire » que déclame le malin Claude Dauphin, voix off tout sauf morose, quasi à la Guitry, le presque