La Collectionneuse : On se calme et on boit frais à Saint-Tropez
Coucher le premier soir ou se séparer soulagés, oublieux des au revoir.
En France, en 1967, on ne plaisantait
pas avec l’accès aux cinémas. Voilà par conséquent une œuvre du pudique Éric Rohmer
interdite aux moins de dix-huit ans, diantre. En 2018, en France, la décision
de classification semble surréelle, surtout à l’heure où les pouvoirs publics
se préoccupent d’une supposée dépendance juvénile au X en ligne. Bien avant que
la Clara de calendrier du Fred Coppula homonyme s’échine en 2001, une svelte
« salope » sème la zizanie, pas celle de Zidi, certes moins leste,
entre deux amis oisifs et parasites. Dans une villa sudiste guère sadienne se
déroule mine de rien une sorte de huis clos sartrien, marivaudage de classe
d’un autre âge dissimulant clairement une peinture de l’enfer solaire. Le
sous-titre de cet article adresse un salut de saison à l’irremplaçable Max
Pécas mais l’on pouvait utiliser l’intitulé original de Meurtre au soleil (Hamilton,
1982), à savoir Evil Under the Sun. En gros plan, en insert, deux livres apparaissent en indices complices de
l’interprétation, intégrale en morceaux de Rousseau + essai consacré au
romantisme allemand. A priori rousseauiste,
en réalité organisée, ombrée, la nature alentour se pollue de discours et vous
repasserez en matière de bonté, naturelle ou non. Romantique, Haydée ne saurait
ni ne voudrait l’être ; elle papillonne, elle fait don de sa personne,
jamais d’elle-même, pure forme à fantasme découpée à la manière cubiste par l’un
des trois « prologues » liminaires. La pornographie, redisons-le au
passage, procède pareillement et différemment, sectionne l’anatomie, se
focalise sur certaines parties, déploie sa litanie de figures imposées durant
un temps réel abstrait. De son côté, sur une plage provençale ou sur les
hauteurs de Ramatuelle, Rohmer enferme au grand air, au passé ensoleillé, trois
pantins assez mesquins, créatures sans généalogie, sans alibi, à peine pourvues d’un piètre projet professionnel, par
exemple celui d’ouvrir une galerie à Paris.
Tant pis pour le « plan à trois »
envisageable, sinon souhaitable selon le spectateur salace venu jadis
s’encanailler au creux d’une « salle d’art et de répertoire » du
Quartier latin, disons Truffaut admiratif. Dans La Collectionneuse, on
parle beaucoup, on baise peu, on finit par ne plus baiser, par avoir envie de
se tirer, invitation motorisée in
extremis pour l’Italie, eh oui. En coda de L’Enfer pour Miss Jones
(1973), bande idem indépendante et sous
influence de Sartre, Georgina Spelvin se retrouvait incarcérée, damnée au
royaume cellulaire de Lucifer, condamnée à écouter les insanités d’un cinglé
impuissant, Damiano himself, et à
s’astiquer son rosebud en vain, privée
de l’espoir d’atteindre un septième ciel inhumé. Mademoiselle Politoff, vingt
ans et toutes ses jolies dents, se contente de disparaître de la scène, du
film, du récit off, évanouie vers de
nouvelles conquêtes suspectes, stériles. Adrien se retrouve à nouveau seul dans
une maison vide, fantomatique, en rime à l’ouverture, son errance d’abandonné
par la sœur de BB, d’ailleurs compagne de Patrick Bauchau, conclue par la
découverte de statues dévêtues, de Haydée en train d’être couchée sous un corps
presque mort, ébats mutiques davantage que lubriques. Un chouïa jaloux, il
réserve son vol en pensant à sa Mijanou partie à Londres pour un shooting. Épris de collections, Rohmer
s’intéresse à une collectionneuse et à un collectionneur, vase renversé à
l’instar des sujets un brin bressoniens à l’horizontale sur leur oreiller de
logorrhée. Ici, Haydée le dit à raison, on jacte pour s’écouter, pas pour
dialoguer avec autrui, pas pour sonder ce qui se tient sous la surface lisse,
sportive, de bobos anachros. Le langage agit à la façon d’un corsage, à la fois
il maintient l’éclatant objet du désir et le tient à distance, il souligne son
caractère obsessionnel et l’agonit d’une misogynie de dandy à transformer fissa l’imbuvable Pierre Woodman aux castings sinistres en militant du MLF.
Notre Adrien, pas aussi stoïque que
l’empereur songeur, pourvu d’un H, biographique, de Marguerite Yourcenar, se remémore cet « éternel été » à la Camus,
non parvenu à ses fins, d’austérité de privilégié ou de consommateur
moralisateur de « boudin » équipé d’une coiffure de garçonne entre
Louise Brooks et Mireille Mathieu. Moraliste, c’est-à-dire scrutateur des
mœurs, Rohmer se garde de faire la morale à ses personnages et au public, il
fait s’affronter les milieux sociaux plutôt que pratiquer une sociologie
appliquée, en partie improvisée. Le fils d’un inventeur du « yacht en
plastique », à lunettes onéreuses de parvenu, ne connaissant pas l’acception
du mot magenta, confondant Polaroïd
et polarisées, se voit ainsi exécuté par Adrien en faux médecin et l’Américain
entiché d’antiquités asiatiques, Méphisto réglo muni de son carnet de chèques,
reproche à l’esthète sa paresse, son parasitisme, au cours d’une conversation à
contre-courant, apologie du courage de ne rien faire, de ne pas travailler,
avant-goût de l’hédonisme d’un Noiret relooké par Robert en Alexandre
le bienheureux (1968) et bien sûr sous-texte hexagonal-mondial
d’événements se produisant un an plus tard, au mois de mai. Invisible à
l’instar du proprio Rodolphe, prénom d’amant flaubertien, relisez Madame
Bovary (1857), l’amour ne séjourne pas dans la demeure luxueuse de La
Collectionneuse, premier film en couleurs et peut-être le plus sensuel,
sensoriel, désolé, de son auteur. Dès le début, quelque chose cloche au cours
de la discussion sur les moches que l’on ne peut aimer, sur le défilé de Haydée
esseulée au bord de l’eau salée, en maillot pas beau. Rohmer raccorde les deux
instants par un son d’avion insistant, vaguement menaçant. Le cinéaste,
notoirement énamouré d’architecture, pas uniquement chez Murnau, parcourt les
pièces douces et obscures d’un centre pénitentiaire tropézien et le bateau
d’affaires amarré au port du gendarme Cruchot depuis 1964 évoque la nef funeste
de Nosferatu.
La Collectionneuse séduit principalement par cette
tension unissant un érotisme maritime et un inassouvissement constant, par sa
capacité à dévoiler la vacuité de silhouettes trop parfaites pour être
honnêtes, envers elles-mêmes ou leur semblable misérable, souriant et
pontifiant. Adrien veut savoir ce que signifie le sourire de Haydée, il ne
paraît pas comprendre que la jeune femme s’apparente simplement, littéralement,
à une pièce de collection, une invitée réifiée, un corps étranger dans la
relation gentiment homoérotique entretenue avec Daniel, auquel Daniel
Pommereulle prête ses traits de sosie d’Eustache et son énervant claquement
colérique, puéril, d’espadrille endeuillée devant un miroir évidemment narcissique,
surcadrage de l’otage en cage, consentante et désarmante. Le copinage
supporte-t-il le pantalon ôté, immaculé, la fermeture Éclair défaite sur une intimité
non offerte ? Le Genou de Claire (1970), dénudé, convoité, égale-t-il
celui de Haydée ? La salle de bains de La Collectionneuse
s’inspire-t-elle de celle du Mépris (Godard, 1963), la blonde
Brigitte recouverte d’une perruque brune en écho capillaire ? Avec ce « conte
moral », quatrième d’une série de six, le réalisateur reprend
l’énonciation subjective de La Boulangère de Monceau (1962),
petit exercice de ratiocination masculine, annonce le marivaudage estival de Pauline
à la plage (1983) et le filigrane funèbre des Nuits de la
pleine lune (1984) ; pourtant, pas d’épiphanie a contrario du Rayon vert (1986) ni de happy ending en mode Les
Amours d’Astrée et de Céladon (2007). Bien entouré par Georges de
Beauregard & Barbet Schroeder, par Nestor Almendros, of course, magicien modique, Rohmer signe un film libre, un film
d’amis, de vacances, un film à succès récompensé à Berlin, par économie tourné
en muet puis postsynchronisé par les intéressés, effet spectral, durassien, renforcé.
Un objet incongru le cristallise, symbolise sa
grave légèreté, matérialise son absence de merci : un pot de peinture
devenu sculpture, boîte de conserve colorée ornée de lames de rasoir, belle
trouvaille d’accessoiriste et clé polysémique de la fable inoffensive, fatale.
En supplément, le DVD propose un court métrage évocateur, Une étudiante d’aujourd’hui
(1966), dont l’héroïne BCBG, silencieuse surplombée par la voix alerte
d’Antoine Vitez, se forme en faculté, bosse au CNRS, écoute du Ravel, irait
voir Hiroshima
mon amour (Resnais, 1959), incite sa progéniture baignée, bien-aimée, à
dire « Papa » au paternel porté sur la photo, qui démontre le talent
de documentariste documenté, drolatique, attentif et productif du sieur
Rohmer.




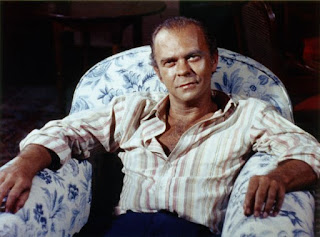











La belle est aussi insaisissable que la métaphore de ...l'hymen...
RépondreSupprimerdigne minois d'un Greuze (la cruche cassée) revisité par le réalisateur qui avait matière à observation dans l'entourage proche...
Et comme l'écho corrigé du célèbre tableau d'Otto Dix peint en 1926, consacré à la journaliste Sylvia von Harden, autre rime féminine, assez sociétale, d'une femme fatale autant que picturale...
Supprimer