Les Mutins du Yorik : Les Marins perdus
Suite à son visionnage sur le site d’ARTE, retour sur le titre de Georg
Tressler.
« Avoir faim, c’est humain. Être
sans papiers, c’est inhumain » : trois ans après le surfait Les Demi-sel (1956), Tressler retrouve Horst Buchholz pour une croisière
qui ne s’amuse pas, qui peut se résumer par la double réplique supra, dont l’actualité se vérifie
aujourd’hui, y compris dans la langue, sous forme de substantif. Sous ses
allures de série B soignée, à l’allemande, entre mecs, tant pis pour la
juvénile et jolie Elke Sommer, mémorable chez Mario Bava, par deux fois, ici
entrevue au début, pieds nus, prénommée Mylène, chef de gare de dernier regard,
d’hospitalité, de soleil, se dissimule à peine, en subjective vérité, une fable
kafkaïenne sur le fatum. Comme Joseph
K., Philip Gale, délesté de son livret de navigateur, d’une poignée de billets,
par une prostituée rusée, taciturne, cesse d’exister, de décider, subit un sort
acharné, embarque à bord d’un « tombeau flottant », cf. le titre
original, vaisseau des décédés baptisé d’après Shakespeare, sur lequel le
conduit un Judas juif polonais pathétique, homme à l’harmonica avant celui de
Leone, auquel Mario Adorf prête sa tendresse de colosse. Épaulé par un duo de scénaristes,
le Hans Jacoby du Fantôme de l’opéra, la recommandable version d’Arthur Lubin
avec Claude Rains sous le masque, le Werner Jörg Lüddecke du Tigre
du Bengale + Le Tombeau hindou, diptyque synchrone
de Lang loué par votre serviteur, le cinéaste transpose le roman d’un ancien
syndicaliste au CV romanesque, B. Traven, souvent adapté au ciné, notamment par
un certain John Huston du côté de la Sierra Madre, amen. Moins satirique, plus contemporain que la chasse au trésor
ratée de Bogart et ses sbires, Les Mutins du Yorik confère au sens
illustré de l’échec une dimension politique, historique et métaphysique.
Quand le soutier floué, spolié,
s’oppose sur l’épave au capitaine immaculé, petit enculé assisté d’un second atteint
de psoriasis prévoyant de couler le rafiot assuré, de se carapater via l’unique canot en mode Titanic, on
assiste à une bonne leçon de marxisme maritime. Quand la recrue imprévue
s’interroge à terre sur son crime, sur ce qui explique une telle malédiction de
mélodrame en mer, sa supposée nationalité américaine n’illusionne personne et l’on
voudrait presque l’inviter à visiter Auschwitz, par exemple en suivant des
rails ruraux, hexagonaux, très connotés, histoire de se faire une idée des « crimes
contre l’humanité » commis par ses pères, ses frères, ses oncles, ses
compatriotes plus âgés, d’autant plus que l’acteur naquit en 1933, date
d’accession au pouvoir d’un sinistre moustachu, vu ? Quand le navire du
pire, peuplé de spectres crasseux à des années-lumière du somptueux James Mason
de Pandora,
autre errant à moitié allemand, réécoutez Wagner, finit par se briser, esquif
fautif coupé en deux par le ressac, le tandem
de survivants, promis à un trépas rapide, en rime aux sorties de Vanel puis
Montand dans Le Salaire de la peur, remarquez la noirceur, la sueur, les
marcels similaires, le filigrane gay soustrait,
acquiert un faux air de naufragés à la Beckett, à la Mylène, bis, Farmer & Seal dans la piscine
tempétueuse de Laurent Boutonnat, matez le clip des Mots, à la dérive sur un
radeau médusé, de sidération, d’hallucination, de disparition. Inutile
d’attendre Godot, d’espérer in extremis
l’intervention du Ciel complice – Les Mutins du Yorik se termine sur le
plan assez superbe d’un homme isolé, à l’agonie, perdu parmi l’immensité de la
mer, de l’air, instant néantisant l’interminable et oscarisable Seul
au monde de Zemeckis sponsorisé par FedEx.
Lesté du poids du passé, d’une
culpabilité généralisée, tourné dans un noir et blanc carré-coupant dû au
brillant Heinz Pehlke, d’ailleurs DP sur le Monpti de Romy + HB, Les
Mutins du Yorik ne flanche pas, évite de sacrifier au happy ending, relit le pacte faustien de Goethe et la force du destin de
Verdi. S’il s’inscrit dans des courants reconnaissables, « réalisme
poétique » et « fantastique social » ; s’il navigue dans
les eaux troublées de Pépé le Moko, bateau parti compris,
de Maya,
huis clos pareillement sépulcral, des Orgueilleux, exotisme étouffant idem ; s’il porte témoignage de sa
période, doublement, puisque des munitions se voient maquillées en camelote de
compote de prune, direction l’Afrique du Nord, afin d’alimenter a priori un conflit d’indépendance,
« guerre sans nom » franco-algérienne réduite à des
« événements » pacifiés, enfin, en 1962 ; s’il parvient à
rejoindre notre époque de « migrants », Ulysse combatifs et
dépressifs débarqués sur une Europe falote, le métrage de Georg Tressler,
co-production entre l’Allemagne et le Mexique, pays d’adoption, d’élection, de
l’écrivain sous pseudonyme, dépasse le cadre chronologique, métaphorique, pour
atteindre une dimension de moralité contemporaine. Cet univers sans dieu,
majuscule implicite, sans justice, espoir, avenir, horizon, envasé dans une
immanence dépourvue de transcendance, de bienséance, englué dans une permanence
infernale, tu le reconnais tien, lecteur, lectrice, à moins de vivre dans un
monastère, un couvent, en ermite ou en humaniste. Film sec et précis, film
existentialiste, naturaliste et symboliste, muni d’une dantesque chaudière
vénère aux allures de four crématoire de terrible mémoire, Les Mutins du Yorik possède
en outre une « parenthèse enchantée » de bonheur éphémère, illusoire,
digne de son homologue dans La Grande Illusion et peut-être davantage
poignante, allez, déploie une noblesse de contrat meurtrier refusé, adieu à la
rédemption administrative, bonjour au marché où acheter en souriant un châle
nostalgique, un instrument de musique.
Certes, Horst & Mario le portent
sur leurs épaules de parias, Elke l’illumine de sa candeur antique, lucide,
déjà désenchantée, mais l’ensemble de la distribution ne démérite pas, croyez-moi.
Je ne sais ce que vaut le reste de la filmo de Tressler, je m’en fiche un brin,
du haut de ma vie raccourcie, je peux cependant vous assurer que son odyssée de
poche vaut son billet, de cinéma chez soi, de voyage vers le naufrage. Je
n’écris pas à propos d’un chef-d’œuvre méconnu, d’une pièce maîtresse oubliée,
à placer entre Murnau & Fassbinder, surtout ceux du Dernier des hommes et de Querelle,
je célèbre à sa mesure, sans démesure, une œuvre de valeur, innervée de
rancœur, de douceur, de détresse, de violence, de solitude, de finitude, de
mélancolie, de suie et de tragédie. Avec son Anvers liminaire, mutique,
d’arnaque sexuelle à la Left Bank, de prologue
nocturne à la Psychose, son commissariat germanique, sarcastique, décoré d’une
affiche de récompense en français, son errance programmée, étatique,
transfrontière, son rêve avarié de retourner à La Nouvelle-Orléans, Obsession
à la con noyée dans l’impitoyable « principe de réalité », sa
maîtrise du studio tressé aux extérieurs d’Espagne, son assassinat de
récalcitrant jeté à la baille, ses funérailles de binoclard sacrifié, bouffé
par la fumée, sa solidarité de démunis damnés de déréliction, sa brune serveuse
généreuse d’escale triviale, sa scène de désastre aquatique tétanisante, plus
puissante dans son humilité que le spectaculaire paquebot de parvenu(s) filmé
en bocal, à la verticale, par James Cameron, ce fleuron de la UFA convainc
constamment, contrairement à la sociologie chorale, bancale, de l’opus dessalé cité en introduction. Jamais
science exacte, le cinéma, allemand ou pas, réserve ainsi son lot, son fret, de
surprises réussies, celle-ci à savourer en VO, en ligne jusqu’en avril, beau
poisson péché sans blague, qui ne divague, qui nous dit deux ou trois choses
pertinentes, séduisantes, au sujet de notre précieuse et triste
« condition » amphibie, même en 2018.


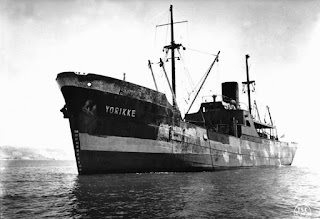









Commentaires
Enregistrer un commentaire