La Maison qui tue : Rien sur Robert
« À vendre » ou à
céder ? En guise de bail, des funérailles, puis une renaissance.
Pour une fois, le titre français se
justifie : que voit-on ici, sinon la mise à mort d’une imagerie ? Bob
Bloch s’y colle, scénariste à cinq reprises du studio Amicus, dont le guère
florissant Le Jardin des tortures dirigé par Freddie Francis. Les vrais-faux
rivaux de la Hammer l’enterrent, débauchent Cushing & Lee, engagent un
débutant sur grand écran. Peter Duffell voulait du Schubert, y compris dans
l’intitulé, mais Polanski récupérera bien plus tard La Jeune Fille et la Mort
pour son propre torture porn
politico-mélomane. The House That Dripped Blood, je propose en VF La
Maison qui suintait le sang, ne manque pas d’humour macabre et son
rythme mortifère convient à une visite de cimetière. On oppose le passé,
baptisé Lugosi, au présent démuni, de canines malignes, sorry Sir Lee. On lit beaucoup, on adresse des clins d’œil à des
auteurs fameux, Poe, Hoffmann, Shakespeare, Stoker, Tolkien, nulle surprise de
la part d’un écrivain se mettant en scène dès le premier sketch, présage de La Part des ténèbres et de Fenêtre
secrète, tous deux d’après Stephen King alors en mode mise en abyme. Le
romancier-nouvelliste-scénariste pratique la forme segmentée, mise sur le méta.
Dans La
Maison qui tue, une caméra en filme une autre, en train de filmer un
cabotin encapé, ensorcelé, mouture de Leslie Nielsen déguisé par Mel Brooks
dans Dracula,
mort et heureux de l’être, in
fine vampirisé par l’irrésistible et iconique Ingrid Pitt, puits de
féminité poumonnée où enfouir son pendule à testicules, ses yeux
surnaturellement bleus durant la métamorphose d’épilogue, la voici s’envoler
aussi sec à Shepperton loin de ses talons aiguilles. Joss Ackland, pas encore
curé enneigé par Boutonnat selon Giorgino, joue les amoureux cireux,
tandis que la séduisante Nyree Dawn Porter interprète la préceptrice d’une
gamine portée sur les poupées, évidemment vaudoues.
Dépassons la schizophrénie de
vaudeville, la fascination de décollation, la sorcellerie en herbe, l’identification
stanislavskienne, le vide inoffensif de l’ensemble symbolisé par le patronyme
du flic de Scotland Yard dépêché en province, bien nommé Mister Holloway coiffé à la Dario Argento. La Maison qui tue, métrage
moyennement divertissant, parfois éclairé par un émule de Mario Bava, succès
aux USA, produit par une firme « amicale » co-fondée par Max
Rosenberg, à moitié signataire de La Cité des morts, trouve sa valeur avérée
en état des lieux de l’horreur. En 1971, Linda Blair ne sait pas quoi faire,
ignore les mères célibataires et les exorcistes suicidaires. En 1971, Terence
Fisher arrive en fin de carrière. En 1971, la boîte au marteau voit double, cf.
les jumelles de miel des Sévices de Dracula. Trois ans plus
tard, Brian Clemens concocte Capitaine Kronos, tueur de vampires,
et Roy Ward Baker emballe en Chine avec Chang Cheh La Légende des sept vampires d’or,
estimable tandem disons exogène,
autant que point de départ dédoublé pour l’esprit satirique de Chapeau
melon et bottes de cuir et celui du drolatique/fantastique/asiatique
Sammo Hung. Les temps changent, l’étrange également, le sang se répand ou pas. Le
Bloch, infidèle hériter de Lovecraft, participe par procuration au tsunami de Psychose,
très librement adapté par Joseph Stefano au service de Hitch. Ed Gein renvoie
aux oubliettes le comte d’opérette, même si Norman Bates ne lui ressemble
point, pas plus que Leatherface. La décennie seventies déploie ses horreurs réelles, cruelles, individuelles et
collectives. Le réalisme s’avère de mise, avant l’ironie, le cynisme, les franchises, le foutage de gueule
d’usage, Wes Craven significativement passé de La Dernière Maison sur la gauche
à Scream.
Le film de Duffell, insignifiant, presque
plaisant, pas dépourvu de sens, utilise à bon escient la métaphore du musée de
cire, ose montrer un Christopher terrifié par une apprentie sorcière, rime
masochiste à la voiture ludique causant la panique de l’inspecteur Harry dans La
Dernière Cible. Dès les premiers plans au sein de pièces obsolètes, L’Écran
démoniaque de Lotte H. Eisner surgit en épiphanie réflexive et
instructive. L’expressionnisme allemand ? Inhumé par Hitler, lui-même
matérialisation historique de tous les spectres psychiques, rajoute Siegfried
Kracauer, essayiste en exil exempt de peur. L’univers d’antan, remember le bestiaire littéraire de la
Universal ? Réduit à néant par Auschwitz, par la nuit et le brouillard de
Resnais substitués aux brumes nocturnes du décor et de « l’inconscient »,
ce mythe freudien idem remis en
cause, à l’époque, par le courant de l’antipsychiatrie. Quand la terreur,
martiale, économique, de fait divers, innerve la réalité, mieux vaut en rire au
ciné dans un huis clos de tombeau, dans une coda de chauve-souris en plastique,
en ombre chinoise, dans un regard caméra de l’agent immobilier rondouillet vous
défiant d’acquérir la demeure du pire, ce lieu censé refléter la personnalité
des acquéreurs, pour leur malheur moralisateur, définitivement ruiné par le
souvenir vivace, réactivé, du « lieu » indicible, infigurable,
cartographié par Claude Lanzmann. Si les années 50 et 60, période de
reconstruction, de reprise, de transition et de séparation urbaine, bien sûr à
Berlin, de conflit refroidi, ouf, entre les vainqueurs russes et américains,
persistaient à héberger des monstres familiers, mis à distance de bienséance,
les années 70 sonnent le glas de cet monde-là, minuit des panoplies dans le
sillage anthropophage de La Nuit des morts-vivants advenu en
1968, tout sauf hasard, tant pis pour la contingence de Pittsburgh.
Depuis plus de quarante ans, enfants
devenus quasiment incontinents, magie noire de l’âge, du naufrage de la body horror cronenbergesque, nous vivons
tous dans l’asile mondialisé du Système du docteur Goudron et du professeur
Plume, dans la maison hantée à domicile, en permanence, par nos
atrocités incessantes, médiatisées, amnésiques. Inondés par les torrents
écarlates de l’Overlook rebâti par Kubrick, nous pataugeons dans des marécages
démultipliés sur les écrans de notre modernité, dans les pages sales du
journal, dans les miasmes de nos intimités. Robert Bloch, fossoyeur de farces
et attrapes, ne cherche plus l’effroi, il congédie avec le sourire les frissons
d’autrefois, il referme le chapitre du livre caduc et la grille du manoir
arrivé trop tard. Raconté à l’imparfait, La Maison qui tue, film imparfait,
expose pour mémoire un espace-temps ressassé, un peu paupérisé, une malédiction
désormais hors-saison. Peter Cushing peut donc dorénavant se faire décapiter
auprès de sa Salomé, Christopher Lee succomber à une cheminée malicieuse
davantage qu’irrévérencieuse. Le cinéma dit horrifique devait vraiment se
réinventer afin de continuer à nous émouvoir – en 2018, l’avertissement vaut
toujours, mon rouge amour.
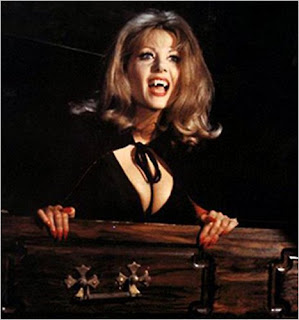







Commentaires
Enregistrer un commentaire