Feeling the Graze : Évocation d’une possession
Some outlaws
lived by the side of the lake
The
minister's daughter's in love with the snake
Who lives in
a well by the side of the road
Wake up, girl
! We're almost home
Jim Morrison,
Celebration
of the Lizard
Kafka décrivit un combat ; voici un ressenti – ceci et rien de plus.
Une femme blanche, oh, sa peau si
blanche (d’albâtre, diraient les littéraires de naguère), à la tête renversée,
nous offre sa gorge (physiologie et euphémisme du dix-huitième siècle désignant
la poitrine féminine) comme un long cou de cygne, surmonté de l’anguleux visage
à la forme de marteau (les lèvres sensuelles révèlent Isabelle), certes pas
celui de la philosophie appelée de ses vœux impies par Nietzsche.
Une ombre violette nimbe les
mâchoires, collier estompé dessinant la base de la face, son sommet surmonté par
des narines fines.
Sa chevelure bruisse d’un entrelac racinien
de serpents bruns, répugnant et séduisant amas de courbes en mouvement,
partouze élégante et labyrinthique de mille désirs tressés les uns aux autres,
dont l’une descend, parvient à se libérer, jusqu’à son sein gauche,
reproduisant le geste suicidaire de Cléopâtre (mords-moi mon mamelon, soupire
la reine à sa vipère altière), tandis que l’ophidien duo lui sert de décolleté
vivant, robe sifflante pour sa chair laiteuse et maladive en sautoir.
On ne voit pas ses yeux, seulement sa
posture amputée, sa cambrure arquée, cette tension du buste (et du corps en
dessous, deviné) pouvant exprimer aussi bien l’agonie de la victime volontaire,
son « bonheur dans l’esclavage » (Jean Paulhan à propos d’O) de ses
bras liés, que l’extase de la religieuse renversée dans sa transe, pénétrée de
toutes parts, de partout, par les auxiliaires de son plaisir supraterrestre, à
l’instar de Georgina Spelvin découvrant les joies serpentines de l’au-delà
(sous la ceinture) sexuel.
Crie-t-elle ? Gémit-elle ?
Appelle-t-elle au secours, noyée dans sa transsubstantiation océanique (moi
très fort, mon amour) ?
Au spectateur-voyeur, croyant ou
athée, célibataire ou marié, cinéphile ou mélomane, de se faire son petit film
pour adultes (consentants).
Méduse médusée, l’inconnue se met à
nu for your eyes only, ou quasi, puisqu’elle semble surgir de
l’esprit d’un(e) enfant également privé(e) de regard, créature asexuée,
décapitée, silencieuse dans l’ombre de son col rouge (pull-over judiciaire ?).
L’innocence enfantine n’existe pas,
pas plus que l’éternité, la vie après la mort, la grâce ou le pardon.
Le sens se dérobe à chaque fois, plus
glissant qu’une anguille, il incite à faire l’épreuve des choses, des êtres et
du monde, des œuvres humaines, à éviter de plaquer sur cet instant de présence
absolue un faisceau de significations, une histoire ressassée, une rhétorique
critique.
Pratiquons la dénotation et cédons
volontiers la connotation (dehors, Rorschach et son foutu test).
Dans sa conscience, tant de
monstruosités, tant d’ardeurs inusitées.
Dans son cerveau bouillonne une
propension à s’ouvrir, à souffrir, femelle offerte à la marée masculine, ce
mascaret de la puberté, ce grouillement figé d’élans naturels et culturels (le
soir, dans l’intimité de son lit solipsiste, elle explore le champ ravissant
des possibles de son anatomie nubile).
La créature de Carlo renvoyait à
l’emprise charnelle et spirituelle d’un dédoublement, à un accouplement hideux
avec sa propre identité scindée, la Belle et la Bête copulant dans une comédie
noire à Berlin, ville blafarde, utérine (s’auto-accoucher dans le métro), matérialiste
et communiste, territoire damné d’une quête religieuse et existentielle.
Ici, la belle dame sans merci, avec
sa coiffure de morsures, s’épanouit dans l’imaginaire d’une gamine, en miroir
du marié Henry perdu à Philly et rencontrant une jolie chanteuse défigurée dans
un radiateur mental.
Femmes entre elles et loin de Michelangelo ?
Pas tout à fait.
Un homme se tient à l’arrière-plan,
plaqué sur le fond souffreteux, au jaune des flammes souterraines en
rétribution de nos péchés.
Ses lourdes mains (une montre à son
poignet gauche, pour minuter la durée itérative des châtiments incessants)
s’appuient sur une sorte de pupitre, peut-être pour un prêche (adressé aux
perverses revêches), un procès (kafkaïen), une allocution à la foule (à nous
tous), un meeting électoral d’avocat
du mal (mâle) floral.
Un troisième bras, le sien ou pas,
enserre les seins de la suppliciée, vient se ficher dans son aisselle, presser
sa peau de morte.
Costume noir et chemise livide, bague
de dandy baudelairien au doigt, ce membre
traverse l’image en son centre ou presque, rompt les diagonales et les cercles,
dynamise une géométrie graphique et symbolique.
Du signifiant à foison, jamais de
signifié avéré, affirmait à raison Michel Chion au sujet des masques orgiaques
de Stanley Kubrick.
Le collage des éléments, l’assemblage
des moments, le télescopage des références, provoquent un effet d’ensemble à
lire à la façon d’une allégorie sur la captivité, choisie ou subie, sur le
droit de propriété appliqué à la sexualité, sur l’enfer privé (Rollin remue) de
la subjectivité individuelle (et générationnelle).
Ne craignons pas de nous
répéter : cette analyse précise, cette lecture aimablement immature (ah,
le sexe, cet opium épuisant, surfait, sentimental), ne valent qu’en tremplins,
en parfums suscités par la sensibilité d’Audrey, sa cinéphilie et son talent
graphique.
Au cœur de ses collages
s’épanouissent les promesses d’un décollage, qui se moque assurément et
royalement d’une quelconque sémiologie, même amie.
La poésie, verbale ou visuelle,
toujours sonore (entendez-vous les sifflements des tiges souples et
tendues ? Nous, oui), explication orphique de l’univers, pour paraphraser
le cher Mallarmé, jamais ne s’abolit en un sens précis, univoque, invite avant
tout à son expérience sensorielle, tel un corps amoureux donné dans une
étreinte (d’où l’échec congénital de la pornographie, royaume pauvre à deux
dimensions, surface faussement spéculaire réduite à deux plans, la profondeur
de l’espace et des sentiments uniquement repérable par effraction).
Parler avec elle ou écrire sur sa
production revient in fine, hélas, à exposer à satiété sa
propre personnalité, chaque texte consacré à un film, un livre, un disque, à
prendre au final en simple et (très peu) détourné autoportrait.
Parviendra-t-on un jour à s’extraire
de sa chair pensante et bandante (ou
humide) afin de vraiment découvrir autrui, de se découvrir devant lui (elle, de
préférence, merci), histoire de percevoir l’extérieur – éprouver l’écorchure,
implore le titre-caresse – dépourvu des filtres innombrables (éducation,
civilisation, mémoire, croyance) qui obstruent plus qu’ils ne tamisent, qui
emprisonnèrent Anna/Helen chez Andrzej, alors qu’elle tentait d’exister dans « l’heure
de la sensation vraie » (Peter Handke) ?
Exercice profitable, Monsieur (Lang),
Mademoiselle (Jeamart) et tant pis s’il aboutit à une défaite, un petit article/présent
de convalescent (l’âme en rade) écrit au présent dominical ; d’autres
accidents de voiture surviendront, ma chérie, d’autres occasions de s’épancher
en complicité, en fidélité (je garde Sophie Marceau et te laisse sans regret
Guillaume Canet), d’autres images de toi catalyseront ma prose.
Si cela te dit, prenons la pose et
osons penser ce qui nous excède et nous identifie, en partie.
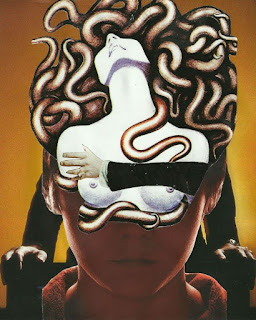



Commentaires
Enregistrer un commentaire